Lorsque l’ami Zez m’a demandé de témoigner concernant mon quotidien en tant « qu’agent hospitalier », j’ai commencé à me gratter l’arrière-train et à entonner un refrain plus rôdé que mes pensées.
Tout d’abord, je lui ai proposé de lire mes deux derniers articles Vent d’âme et Adaptations que l’on peut trouver sur mon blog en lui disant :
« Peut-être que tu trouveras dedans ce que tu cherches ». J’étais content de moi. Je me suis dit qu’encore une fois, même si lui et moi nous connaissons finalement assez peu, certaines de nos préoccupations se rejoignent.
Et, puis, Zez m’a recontacté :
« J’aime beaucoup tes articles mais c’est trop (ou très) poétique. Ce n’est pas ce que je recherche. Ce que je veux, vraiment, c’est comment tu vis, comment, lorsque l’on est agent hospitalier, on vit l’épidémie dans son quotidien. Comment vous vivez avec ça. Parce-que vous êtes quand même supposés être les sauveurs de la Nation… ».
Et, là, j’ai été coincé. J’ai à nouveau ressenti en mon fors intérieur cet interdit déjà ressenti plusieurs fois lorsqu’il s’agit de s’exprimer en tant qu’infirmier sur la place publique. Bien-sûr, entre-temps, j’avais compris que lorsque Zez parle « d’agent hospitalier », il ne pense pas forcément à un ASH, un agent de service hospitalier comme je l’ai d’abord pensé. Mais à tout agent hospitalier. A toute personne qui travaille dans un hôpital public et qui, du fait de l’épidémie, se trouve officiellement engagé depuis cette semaine dans cette « Guerre sanitaire » dont a parlé et reparlé notre Président de la République à la télé. Ainsi que son Premier Ministre et/ou son Ministre de l’intérieur, je ne sais plus.
Mais il existe souvent un mur entre cette demande, spontanée, de bien des personnes qui souhaiteraient que des professionnels de l’hôpital s’expriment. Et les professionnels de l’hôpital qui peuvent hésiter ou refuser de le faire. Je ne parle pas, évidemment, des médecins et des psychologues qui sont souvent les plus sollicités ou les plus volontaires dès qu’il s’agit de s’exprimer sur une situation donnée dès qu’il s’agit de l’hôpital et, cela, bien avant l’épidémie actuelle.
Non, je parle de tous les autres qui sont, par ailleurs, souvent les plus nombreux et que l’on pourrait presque surnommer la « majorité » silencieuse, souvent anxieuse, peureuse ou voire honteuse à l’idée de s’exprimer à visage découvert. Et même sous couvert d’anonymat.
Parce-que, comme je l’ai expliqué à Zez au téléphone, car il m’a semblé nécessaire de le lui dire directement par téléphone plutôt que de poursuivre notre correspondance par sms :
« A l’hôpital, la parole n’est pas libre ».
J’ai ajouté :
« Moi, encore, j’écris et je suis plus ou moins à l’aise pour m’exprimer en public mais ça n’est pas le cas de beaucoup de mes collègues ».
« Dans certains de mes articles, je parle de certaines et de certains de mes collègues. Pourtant, même si je fais en sorte que personne ne les reconnaisse et qu’à mon avis, personne ne les reconnaîtra en lisant mes articles, je ne suis pas sûr que certaines et certains d’entre eux, en se reconnaissant dans un de mes articles, ne m’en veuille pas ».
Et, très content de moi et de mon argumentation, car j’étais inspiré et Zez semblait de plus en plus convaincu par mes arguments, j’ai placé ce qui était l’estocade :
« Il faut savoir que dès le début de notre formation, nous sommes formés au secret professionnel… », ce que Zez a traduit de son côté : « Ah, oui, le serment d’Hippocrate ».
Je n’ai même pas essayé de lui dire que le serment d’Hippocrate concerne les médecins. Pour moi, Zez, avait compris ce que je voulais dire : notre parole, en tant qu’agent hospitalier, n’est pas libre. Nous sommes surtout libres dans le silence et l’anonymat.
Je me rappelle que Zez et moi, nous sommes quittés au téléphone avec l’idée qu’il essaierait de piocher dans mes deux articles ce qu’il pourrait. J’ai oublié si je lui ai dit que j’allais réfléchir. Par, contre, oui, je voulais bien lui fournir la play-list des morceaux de musique que j’écoute pour me changer les idées en ce moment.
Depuis, une nuit est passée. Et, cela m’a apparemment permis de « dé-rusher » ma conscience.
D’abord, je suis retourné au travail à vélo. A 20h, hier soir, je me trouvais dans une des rues- plutôt désertes- d’Asnières, lorsque j’ai entendu des gens applaudir. Je « savais » que ces personnes, depuis leur balcon, applaudissaient les soignants pour les remercier et les encourager. J’en avais été informé par une chaine de messages reçus sur ma messagerie messenger. Mais aussi sur un des panneaux d’information dans ma ville.
Je sais très bien que je ne suis pas Superman. Que je ne suis pas un héros. Mais entendre ces applaudissements alors que me dirigeais à vélo au travail a fini par m’atteindre. Même si ces gens qui applaudissaient dans cette pénombre claudicante ne pouvaient pas savoir qui j’étais vraiment. Même si je me suis dit que sur mon lit de mourant, ces applaudissements ne me guériraient pas. L’attention et la bonne humeur de ces personnes étaient sincères et cela m’a quand même fait plaisir de faire partie de celles et ceux à qui ces applaudissements étaient adressés.
Pourtant, j’ai été soulagé lorsque les applaudissements se sont arrêtés. Oui, soulagé. Sans doute estimais-je que je ne méritais pas ces applaudissements. Et que « d’autres », des vrais soignants, des vrais héros, les méritaient bien plus que moi.
Mais, comme on le dit, on est souvent « l’autre » de quelqu’un ou de quelque chose.
Près de Levallois, j’avais un pied posé à terre au feu rouge lorsqu’une fusée est passée à côté de moi. Une femme à vélo. Sans casque. Elle m’a rapidement mis à peu près cent mètres dans la vue. Je compte reparler des femmes que j’aperçois dans les rues lorsque je vais au travail à vélo ou en reviens ces derniers temps.
A quelques mètres de mon service, rebelote, je tourne la tête, qu’est-ce que je vois ?
Une jeune femme à vélo sur la route, portant un cycliste noir. Celle-ci, dotée d’un fessier de pistarde grimpait la route avec conviction. Comme la précédente, quelques kilomètres plus tôt, elle roulait sans casque.
Dans le service, lorsque j’ai rejoint les collègues dans la salle de soins pour les transmissions, cela a été très vite une autre ambiance.
Depuis ma dernière nuit de travail, deux nuits plus tôt, notre service de pédopsychiatrie s’était transformé en service de bloc opératoire. Deux jours plus tôt, nous étions tous avec nos vêtements de la vie civile comme d’habitude. Là, par dessus leurs vêtements civils, ou voire avec simplement leurs sous-vêtements en dessous, tous mes collègues portaient un masque chirurgical et s’étaient mis en « pyjama » en papier de bloc de la tête aux pieds. Manquaient la charlotte, les gants stériles et les chaussures de bloc. Mais tout le monde était déjà suffisamment équipé pour que soit tourné un épisode de la série Urgences.
J’étais bien-sûr au courant : un jeune hospitalisé récemment avait été en contact, avant son hospitalisation dans « notre » service de pédopsychiatrie, avec une personne qui s’était avérée porteuse du coronavirus Covid-19.
Alors que les transmissions se déroulaient, je digérais l’information suivante : notre environnement professionnel et, donc, notre comportement de professionnel et d’individu, avait été modifié rapidement. Telle une fonte brutale des glaces entre l’hiver et le printemps dans certains régions.
Qu’y’ a-t’il de si particulier dans le fait d’apprendre que des soignants, dans un service hospitalier, portent chacun un pyjama de bloc et un masque chirurgical dans un contexte de grande épidémie qui concerne le pays ?
D’abord le fait que ce genre de précautions et d’attitudes tranche avec notre univers mental en psychiatrie. Même si, on s’en doute bien, le coronavirus covid-19 ne va pas faire d’exception pour nous qui travaillons en psychiatrie.
Le virus ne va pas se dire :
« Je suis le Grand Méchant Loup qui laisse tranquille tous les petits cochons qui se sont réfugiés en psychiatrie et en pédopsychiatrie…. ».
Ce qu’il y a de particulier, c’est qu’un soignant, quelle que soit sa spécialité, en psychiatrie ou en soins somatiques, n’est pas un individu que l’on sort d’un coma artificiel prolongé- ou d’une éprouvette- comme on le voit dans un film de science-fiction et à qui l’on dit :
« Réveille-toi, va soigner et sauver les gens sans te retourner derrière toi ». Ce sera peut-être comme ça un jour. Mais, pour l’instant, une soignante, un soignant, c’est encore souvent et toujours, une personne qui a une vie bien particulière en dehors de son travail. Et qui a un entourage amical, familial ou autre. C’est une personne qui a des tracas personnels. Et qui est perméable aux tracas que peuvent vivre ou susciter des membres de leur entourage.
Une soignante et un soignant, c’est aussi une personne qui écoute les informations et qui reçoit des informations par différents canaux. Et, lorsqu’elle ou il arrive au travail, une soignante et un soignant est donc loin d’être une personne « neutre » ou « vierge » de toute influence de l’extérieur. Même si, lors de mes études d’infirmier, on savait nous rappeler qu’en tant que professionnels, nous nous devions d’être…. « objectifs ». Evidemment, il s’agit, pour rester professionnel de savoir trancher, de savoir délimiter mentalement notre vie extérieure de notre vie professionnelle. Certaines personnes y arrivent mieux que d’autres voire peut-être trop bien d’ailleurs, mais penser, néanmoins, que ce qui se passe à l’extérieur, dans notre vie personnelle, n’a aucune incidence, jamais, sur notre vie professionnelle……
Concernant l’épidémie, il y a donc bien-sûr la « Guerre sanitaire » qu’on lui livre actuellement. Mais il en est une autre, plus personnelle et plus solitaire que chaque soignante et chaque soignant livre tous les jours comme tout un chacun. Et, cette guerre personnelle et solitaire, il n’y a qu’elle, il n’y a que lui, qui peut en parler, qui pourra en parler, car il s’agit de la sienne et elle n’intéresse que lui, ses intimes, et, peut-être quelques auteurs et quelques chercheurs qui s’intéresseront ensuite à ce genre de sujet.
C’est à propos de cette guerre-là que Zez m’a interrogé et que, spontanément, j’ai voulu taire sous tout un tas de prétextes.
Même si j’ai fini par lui envoyer un sms où je lui ai proposé d’en parler à quelqu’un que je « connais » que je sais être engagé et qui, selon moi, serait plus « légitime » que moi pour parler.
Oui, « légitime ». Car c’est aussi ce que j’avais expliqué à Zez :
« Tu vas peut-être trouver ça étonnant mais je ne me sens pas légitime pour parler de ce sujet ».
C’était en effet très étonnant !
Depuis des années, je passe mon temps à réclamer la parole, à la prendre, à m’exprimer, que ce soit en écrivant et en me mettant en scène, quand je le fais, en tant que comédien, et par mes écrits et, là, on me demande de parler- j’ai quartier libre- de mon quotidien au cours de l’épidémie et je suis pressé de disparaître des radars.
J’ai réfléchi à ce sentiment d’illégitimité.
Premier constat : je me suis senti illégitime parce-que, par rapport à nos collègues des soins somatiques (chirurgie, urgences, réanimation et autres….) la psychiatrie et la pédopsychiatrie traînent depuis longtemps ce sentiment d’infériorité. Je croyais m’être plutôt vacciné contre cette « supériorité » de la technique des soins somatiques qui m’avait été inculquée dès ma formation. Mon sentiment d’illégitimité m’oblige à me rendre compte que, en pleine « Guerre sanitaire » et alors que l’on parle d’urgence médicale et chirurgicale, un soignant en soins psychiatriques a moins de « valeur » et de « compétences » qu’un soignant de soins somatiques. Un soignant en soins psychiatriques apparaît, en pleine « Guerre sanitaire », comme un sous-soignant ou un soignant au rabais. Et, les quelques infirmières et infirmiers diplômés en soins psychiatriques qui restent pourront très certainement parler de cette déconsidération qui les a souvent concernés lorsqu’il existait encore deux diplômes d’infirmier : un, général, afin de pratiquer dans tous les services hospitaliers avec ou sans spécialisation (anesthésie par exemple). Un autre, en soins psychiatriques, pour pratiquer en psychiatrie, et, éventuellement, en gériatrie.
Pourtant, je sais suffisamment que toute Guerre provoque ses trauma et que l’on sera bien content, à ce moment-là, d’avoir des soignants en psychiatrie et en pédopsychiatrie. Que ce soit pendant la Guerre sanitaire actuelle ou après l’épidémie, on peut s’attendre à ce que les services de pédopsychiatrie et de psychiatrie révèlent aussi toute leur nécessité.
Mais, ça, c’était néanmoins de l’auto-analyse et de l’autodénigrement automatique.
Si nos collègues en soins somatiques ont d’évidentes aptitudes techniques que nous n’avons pas, ou oublions, en psychiatrie et en pédopsychiatrie, je me suis avisé ce matin qu’en fait, mon sentiment d’illégitimité était de toute façon antérieur au début de mes études afin de devenir infirmier. Et c’est mon second constat. Pourquoi ?
D’une part, parce-que je sais un petit peu de quoi est fait ma vie personnelle. Et, pour cela, je peux plutôt remercier mes expériences professionnelles et personnelles en psychiatrie.
D’autre part, parce-que je crois connaître un peu le monde infirmier, d’un point de vue personnel et professionnel, qu’il exerce dans un milieu général ou dans un milieu psychiatrique. Et lorsque j’ai expliqué à Zez qu’à « l’hôpital, la parole n’est pas libre », je parlais autant de la parole d’une infirmière ou d’un infirmier en soins généraux que d’une infirmière ou d’un infirmier en soins psychiatriques :
Parce-que ce n’est pas dans notre culture infirmière de prendre la parole. Même s’il y a des infirmières et des infirmiers qui prennent la parole. Et qui écrivent. Mais il s’agit d’une minorité. Et cette minorité est plus restreinte que la minorité de médecins somatiques ou psychiatriques et de psychologues cliniciens qui « parlent » et écrivent.
On n’est pas étonné d’entendre s’exprimer une personne qui sort de l’ENA ou de Polytechnique ou qui sort d’une école de la Magistrature ou d’une formation d’avocat. Ces professionnels sont formés et poussés à l’art oratoire, à apprendre à séduire l’auditoire comme à lui jouer du pipeau.
Et je ne serais pas surpris que, quelque part, dans le cursus de formation d’un médecin ou d’un psychologue, on retrouve ça : le fait d’être formé – et incité- au fait de s’exprimer, de « présenter un cas » mais aussi de réfléchir et pousser à réfléchir à son sujet. Dans un film comme Elephant Man, la « créature » est recueillie par un médecin brillant qui en fait un cas clinique à même de critiquer la société. Pareil dans l’histoire de L’Enfant sauvage dont François Truffaut ( « né de père inconnu ») a réalisé un film. On ne parle pas d’une infirmière ou d’un infirmier que ce soit dans l’histoire de Elephant Man ou de L’enfant sauvage.
L’infirmier et l’infirmière en soins généraux ont bien les démarches de soins et ce qu’il en reste pour faire ça mais, disons, que ce n’est pas véritablement ce qu’on leur demande le plus. Ce que l’on demande le plus à une infirmière et à un infirmier en soins généraux, même s’il y a des variantes, c’est, d’abord : d’exécuter. Soigner. Soigner et exécuter intelligemment bien-sûr. De savoir pourquoi on réalise telle action pour soigner et comment. Et quand. Pas de penser à ce qu’est la vie en Société ou à ce qu’elle pourrait être, ou à ce qu’elle devrait être. L’infirmier diplômé en soins psychiatriques est sûrement différent. Mais il y en a de moins en moins. Le diplôme d’Etat d’infirmier qui prépare en priorité aux soins généraux a désormais le monopole en terme de formation infirmière. Et, je suis moi-même un infirmier diplômé en soins généraux ( donc diplômé d’Etat) qui a choisi d’aller travailler en psychiatrie il y a plus de vingt ans.
C’est peut-être pour ces raisons qu’hier, je me suis senti illégitime pour parler de mon quotidien durant l’épidémie lorsque Zez me l’a demandé. Alors que, lorsque j’y ai repensé dans la nuit, j’avais ce qu’il me demandait :
Il n’est pas nécessaire d’accomplir de grandes prouesses techniques pour prendre part à une « Guerre sanitaire ». Il y a bien des bénévoles qui aident à distribuer des repas ( ou des couvertures) pendant l’épidémie et personne ne contestera qu’en faisant ça, ils prennent part à la Guerre sanitaire contre l’épidémie.
En tant qu’infirmier, être présent pour assurer « la continuité des soins », pour remplacer des collègues malades, s’occuper des patients, que ce soit dans un service ou au téléphone, c’est déjà participer à la Guerre sanitaire alors que d’autres préfèrent sans aucun doute rester à l’abri chez eux et faire du télétravail. Et c’est, là aussi, un constat. Le Dr House et le Dr Ross ne sont pas les seuls à permettre que la résistance hospitalière l’emporte sur l’ennemi viral et bactérien qui présente des particularités mortelles.
Et puis, je me suis rappelé de mon journal intime. Hier après-midi, j’ai écrit ça dans mon journal après avoir parlé à Zez. Je n’avais pas prévu de le mettre dans cet article puisque j’étais encore dans mon sentiment d’illégitimité et qu’ensuite je me suis dit que j’allais lui proposer quelqu’un d’autre pour s’exprimer sous couvert d’anonymat ( j’ai évidemment retiré et modifié certains passages pour des raisons d’intimité et pour que ça serve l’article) :
« Identité en crescendo, album de Rocé.
Ma fille est dans sa chambre depuis 14h30/15h00 officiellement pour faire sa sieste.
Depuis la dernière fois que j’ai écrit dans ce journal, le couvre-feu a été déclaré par le Président Macron du fait de l’épidémie du coronavirus Covid-19. Il a pris effet cette semaine, mardi ou mercredi. Ma compagne et moi faisons partie des professionnels en première ligne de cette « Guerre sanitaire » qu’a évoquée plusieurs fois le Président Macron dans son allocution présidentielle lundi soir, je crois. Je travaillais cette nuit-là avec F… ma collègue de nuit depuis plusieurs années.
Il s’en est ensuivi une atmosphère assez irréelle : tout, pratiquement, tourne autour de l’épidémie. Confinement, plus de contrôles. Obligation d’avoir sur soi un laissez-passer sur soi en cas de contrôle quand on sort. Je n’ai pas encore été contrôlé mais j’ai vu des contrôles.
Dès l’allocution du Président Macron, j’ai décidé de reprendre mon vélo pour aller au travail. C’est plus loin que pour se rendre à notre ancien service ( 1h05 contre 40 à 45 minutes) mais, au moins, je suis à l’air libre et me farcis moins de contrôles ( des contrôleurs + les policiers) dans les transports en commun. Et puis, ainsi, je subis moins la diminution des transports en commun.
J’ai le moral. Mais je suis étonné de voir comme l’épidémie a opéré une véritable voire une totale occupation mentale de la plupart des esprits. Et nous n’en sommes qu’au début de l’épidémie en France. Je crois que des personnes vont devenir folles à force d’avoir la tête mangée par l’angoisse et en permanence fourrée dans la pensée du coronavirus Covid-19.
Il y a deux jours, un soir, à l’heure du coucher, j’étais au téléphone avec ma compagne lorsqu’elle s’est mise à pleurer. Soudainement. Cela m’a surpris. Je lui ai demandé si elle pensait que nous allions mourir. Elle m’a répondu qu’elle ne savait pas. Qu’elle était fatiguée. Je lui ai dit que je pense que nous ne mourrons pas. Ni elle, ni notre fille, ni moi.
Par contre, je crois qu’il est possible que quelqu’un que je connais meure du coronavirus. Puisque cette épidémie tue.
Rues désertes, transports en commun déserts, télétravail et confinement pour celles et ceux qui peuvent. Les supermarchés, les boulangeries, certains bureaux de tabac ainsi que certains points de presse sont ouverts. Tous les centres culturels et lieux publics divers sont fermés : médiathèques, musées, salles de concerts, salles de projection de presse, cinémas, piscines.
Notre fille, comme les autres enfants de soignants, est accueillie dans une école et un centre de loisirs dans notre ville. Cela lui permet de prendre l’air et de s’amuser avec d’autres enfants. Ses devoirs lui sont envoyés par sa maitresse via internet.
Quelques amis et proches s’inquiètent pour nous, ma compagne et moi, puisque nous sommes appelés à être en première ligne comme d’autres soignants. Pour l’instant, je suis plus inquiet de voir que nous perdons des libertés, que nous entrons dans un Etat policier, et que nous aurons beaucoup de mal à récupérer certaines de ces libertés après l’épidémie.
Je crois que savoir couper moralement de l’angoisse, bien se reposer, et, aussi, éviter d’être trop au contact avec des personnes trop angoissées, font partie des munitions à avoir avec soi pour supporter l’épidémie et la surmonter.
Je n’aime pas cette ambiance de folie générale hébergée par la majorité sur les réseaux sociaux par exemple. Tous les jours, tous les jours. Même s’il y aussi de la solidarité, de l’humour.
J’ai aussi appelé quelques amis et proches. Mais je vais aussi veiller à me reposer et à savoir me tenir à l’écart de celles et ceux qui sont trop angoissés. A couper mon téléphone portable.
Mes prochains articles sur mon blog seront si possible « hors » épidémie, hors du sujet de l’épidémie. Je vais aussi prendre soin de lire ( en ce moment, je lis La Dernière étreinte du primatologue et éthologue Frans de Waal, bon, le titre a un côté funeste mais je l’avais commencé avant le couvre-feu). Et écouter de la musique.
Avant le couvre-feu, nous pensions que X… serait la ville où nous aimerions vivre. L’épidémie va peut-être changer la donne. Sans notre métier, ma compagne et moi serions confinés en permanence lors du couvre-feu car nous n’avons pas de terrasse ou de jardin. Rester tout le temps dans son appartement, c’est usant. Même si on peut sortir pour faire des courses, emmener son enfant à l’école et faire un footing matinal ou emmener son animal faire ses besoins. Ou partir au travail pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail.
Hier soir, ma compagne et moi avons fait le même constat : nous étions vendredi et, en raison de l’épidémie, nous n’avions pas pu prendre le temps de nous occuper de notre fille afin qu’elle fasse ses devoirs. Nous en étions encore aux devoirs de mardi. Nous nous sommes dit qu’elle allait être pénalisée.
Ma play-list pour le moment :
La personne que je pensais plus légitime que moi afin qu’elle parle à Zez de son quotidien pendant l’épidémie a répondu ce matin :
Elle ne se sent pas légitime pour en parler.
Peut-être que mon article va la faire changer d’avis ou inspirer d’autres personnes que je vais contacter et que celles-ci se sentiront suffisamment légitimes pour parler de leur quotidien au cours de cette épidémie. Ce serait bien d’avoir plusieurs points de vue.
Propos recueillis par Ze Z
Franck Unimon, ce samedi 21 mars 2020.


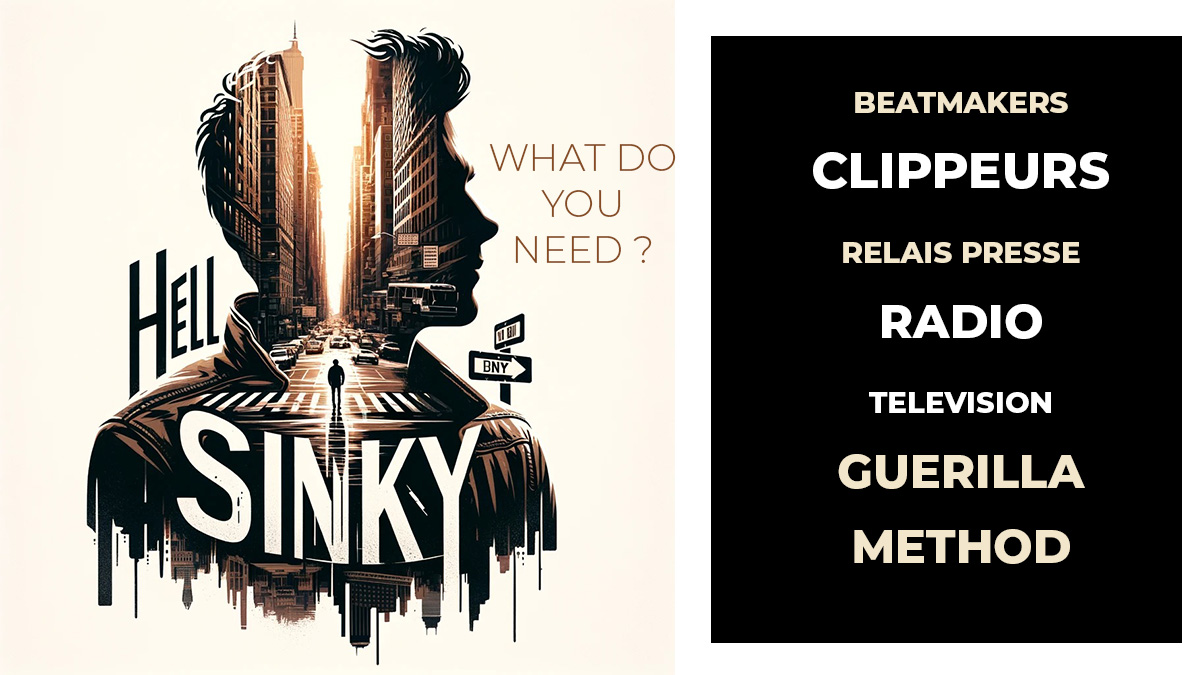
[…] effet, le 1 er aout le rappeur est hospitalisé. Le 4 aout l’information est publique. Et tout ce que le rap a connu de rappeurs et de […]